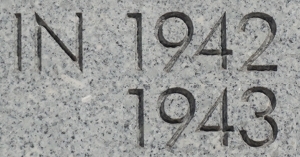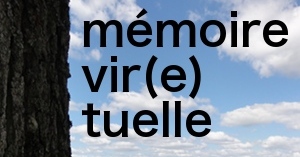« En histoire comme au cinéma tout gros plan implique un hors-champ ». Cette réflexion de l’historien Carlo Ginzburg dans un entretien au Monde en 2022 résume l’objet et l’esprit du projet Mémoire vir(e)tuelle.
Démarré en 2010 à Vire dans le Calvados, celui-ci vise d’abord à étudier les persécutions contre les Juifs de la ville, puis ceux d’autres territoires, à l’échelle locale et régionale. En réduisant ainsi la focale sur des espaces ciblés, il ne s’agit pas « seulement » de tenter de reconstituer les trajectoires individuelles et familiales des victimes, mais de repenser véritablement l’histoire de la Shoah comme un système ouvert, voire indéterminé.
Comment comprendre en effet qu’Adolfo Kaminsky, à peine sorti de Drancy, bascule dans la Résistance par pur hasard en février 1944 ? Comment interpréter la clairvoyance (ou la prise de risque inconsidérée ?) de Slavsko Krausz lorsqu’il quitte Cherbourg et refuse de se déclarer « israélite » en septembre-octobre 1940 ? Pourquoi David Furmanski, évadé du camp d’internement de Beaune-la-Rolande en juillet 1941, est-il dénoncé pour marché noir et arrêté à Vire un an plus tard ? Pourquoi et comment le préfet de la Manche parvient-il in extremis à faire libérer Osnas Nadelman de la prison de Saint-Lô lors de la principale rafle du 22-23 octobre 1943 ? Comment Rosette et Sylviane Augier ont-elles pu échapper aux arrestations, enfants, alors que toute la famille est emportée en juillet 1942, puis en octobre 1943, et alors que deux témoins oculaires affirment les avoir vues emmenées par les Allemands à Neuville ? Comment Abraham Drucker, arrêté à Saint-Sever au printemps 1941 pour ses positions gaullistes et « anglophiles », se retrouve-t-il contraint d’intervenir comme médecin à l’hôtel Excelcior de Nice fin 1943 ?… La liste des questions est longue. Pour chacune d’elle, la réponse est incertaine et montre des contingences nombreuses dans les stratégies et choix opérés par les femmes et les hommes plongés dans un contexte d’oppression durant l’Occupation nazie.
Le hors-champ renvoie aussi à l’emboitement des échelles géographiques : de près ou de loin, les évènements subis par les Juifs de Vire, de Saint-Lô, du Calvados ou de la Manche sont directement liés à des décisions prises à Berlin, Paris, Vichy ou Birkenau. Sans qu’elle le sache immédiatement, le destin de la famille Kaminsky ne tient par exemple qu’à un fil : celui des relations diplomatiques dégradées entre l’Allemagne nazie et l’Argentine fin 1943. Quelques mois plus tôt, Henri Boni est déporté de France par le convoi n°49 : s’il intègre selon toutes vraisemblances le Sonderkommando de Birkenau, c’est parque que l’aménagement de « chambres à gaz intégrées » entre dans une phase opérationnelle avec l’achèvement du Krematorium II…
Enfin, puisque l’instigateur de la microstoria parle de « gros plan » et de de « hors-champs », c’est l’occasion de réaffirmer l’axe privilégié depuis bientôt 15 ans dans le projet Mémoire vir(e)tuelle, à savoir l’image photographique et filmique comme medium de transmission et de création. Toutes les images de toutes les expositions et courts-métrages ont été réalisées avec de jeunes néophytes qui ont su s’investir aussi dans cet apprentissage : qu’ils en soient remerciés encore et encore !

Pour nous contacter : Mémoire vir(e)tuelle 3, rue de l’Exode 50 000 SAINT-LÔ
olivier.queruel@ac-normandie.fr ou memoire.viretuelle@gmail.com
Nos partenaires :